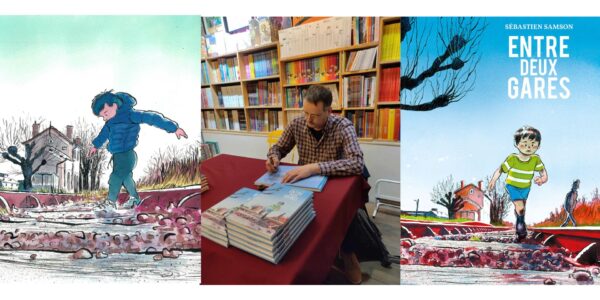Récemment découvert en France grâce au travail des éditions Delirium, Michel Fiffe est pourtant loin d’être un nouveau visage dans le monde des comics Américain. De scénariste à dessinateur, de l’encre à la couleur, il arpente la BD en long en large et en travers depuis bientôt trente ans. Erudit, passionné, Fiffe partage sur les réseaux ses nombreuses influences et références. Il y montre une fascination pour la pop culture et plus particulièrement le monde des comics. L’univers qu’il dessine est pluriel, mouvant, intense et souvent très coloré. Mais derrière cette image fun, il n’en reste pas moins un homme mystérieux. Rencontre avec les pinceaux fous du créateur de Panorama et Copra.
Dans le monde de l’édition, la machine se lance à rebours. Plutôt que de proposer l’œuvre la plus jeune de Michel Fiffe, Delirium a fait le choix malin d’entamer les négociations avec Panorama. Sortie en avril dernier, le récit est une juste introduction à l’univers barré du dessinateur Cubano-américain. Conçue alors qu’il a tout juste 25 ans, Fiffe y fait preuve d’un style très affirmé, passant les tourments de l’adolescence à la moulinette de l’horreur organique et des corps en souffrance. Le récit dont il est difficile de savoir si oui ou non il contient des éléments propres à son auteur, chamboule et fait sortir de sa torpeur nos cerveaux engourdis. Nous y suivons Kim et Augustus, jeune couple en fugue, à la fois en quête d’amour et d’identité. Confrontés à un monde adulte brutal dans lequel il va rapidement leur falloir apprendre à survivre, ils sont également soumis à un pouvoir étrange qui les amène à subir des métamorphoses incontrôlables…
 La suite pour l’éditeur, c’est la série maousse Copra, récit de supers-zéros sortie en septembre de cette année. Nouvelle baffe visuelle située entre le Suicide Squad de DC et le Doom Patrol période Grant Morrisson, Copra nous raconte comment une équipe de laissés-pour-compte est chargée de faire le boulot dont les agences gouvernementales ne veulent pas. Après une opération clandestine qui tourne mal, ils sont contraints de se faire discrets mais jurent de retrouver ceux qui les ont trahis… C’est-à-partir de 2012 que l’envie furieuse de raconter un récit de super-héros très personnel se fait ressentir. Fiffe déchire, avale, malaxe toutes les références qu’il a maniaquement accumulé depuis plus de vingt ans et les couche sur papier avec la vigueur qui est la sienne. Ce premier tome se verra suivi par cinq autres volumes.
La suite pour l’éditeur, c’est la série maousse Copra, récit de supers-zéros sortie en septembre de cette année. Nouvelle baffe visuelle située entre le Suicide Squad de DC et le Doom Patrol période Grant Morrisson, Copra nous raconte comment une équipe de laissés-pour-compte est chargée de faire le boulot dont les agences gouvernementales ne veulent pas. Après une opération clandestine qui tourne mal, ils sont contraints de se faire discrets mais jurent de retrouver ceux qui les ont trahis… C’est-à-partir de 2012 que l’envie furieuse de raconter un récit de super-héros très personnel se fait ressentir. Fiffe déchire, avale, malaxe toutes les références qu’il a maniaquement accumulé depuis plus de vingt ans et les couche sur papier avec la vigueur qui est la sienne. Ce premier tome se verra suivi par cinq autres volumes.
Les échanges qui suivent ont eu lieu par mail. Fiffe, accaparé par son travail et la suite qu’il donne aux aventures de Copra, délivre des réponses directes, franches et sans fioritures. Dans cette interview, il ne sera pas question de son parcours, de comment il s’est passionné pour la BD ou de l’évocation de ses travaux pour Marvel. Afin de mieux approcher la bête, nous avons choisi de nous concentrer sur ses deux récits déjà sortis dans nos contrées.

Rat DEVIL : Ai-je tort de dire que Panorama est davantage l’histoire de Kim que celle d’Augustus ? Son rapport au corps, à la maternité est quelque chose d’incroyable, de troublant, de plus fort encore que l’histoire de son compagnon.
Michel FIFFE : Dans l’histoire, le centre d’intérêt pour les personnages se déplace, passe de Augustus à Kim, culminant en un point d’équilibre mais déformé. Kim a certainement une voix plus définie, plus sûre d’elle mais je vois vraiment ce récit comme une histoire partagée.
Le titre est-il un hommage à l’œuvre d’Edogawa Ranpo et son « Ile Panorama » ? Est-ce une façon pour vous de rendre hommage au genre de l’Ero Guro dont Panorama semble s’être inspiré ?
MF : La seule référence que je connaisse est l’île Panorama du grand Suehiro Maruo (adaptation du roman éponyme d’Edogawa Ranpo, format manga ndlr), mais je n’en avais pas connaissance à l’époque où j’ai commencé à travailler et à publier Panorama, vers 2004. Pour moi, le titre Panorama ne partage aucun hommage, il représente juste une vue d’ensemble plus large que la vôtre.
RD : Il n’y a donc aucune influence des mangas, d’horreur ou non, dans la création de Panorama ?
MF : Si bien sûr ! Je suis un fan de Maruo, entre autres. Ultra Gash Inferno, par exemple, a eu un impact énorme sur moi. Son influence se retrouve dans tout Panorama.
RD: Autres que ces références, comment s’est construit l’aspect graphique de Panorama ?
MF : Comme pour la plupart de mes travaux, il s’agit de l’assemblage de différentes influences. Pendant Panorama, j’ai travaillé à travers Steve Ditko, Jaime Hernandez et Katsuhiro Otomo.
RD : Vous mentionnez Otomo, faites-vous référence à Akira en particulier ou à d’autres de ses œuvres ?
MF : Oui, Akira, car j’ai découvert ses autres œuvres par la suite.


RD : D’où vient cette idée du corps qui se disloque ?
MF : Au départ, il s’agissait d’une représentation de l’anxiété à travers des croquis et des illustrations personnelles mais j’ai ensuite voulu explorer ce que serait une histoire réelle, en donnant de la substance à ces visuels.
RD : Que peut-on trouver de vous dans cette histoire d’adolescence troublée ? Étiez-vous un adolescent punk, torturé ?
MF: Ne l’avons-nous pas tous été à un certain degré ? La romance de l’histoire de Panorama est légèrement plus autobiographique que l’angoisse, ça je le sais avec certitude.
 RD : L’horreur n’est pas très présente dans le reste de votre œuvre, pourquoi cette incursion dans le genre ?
RD : L’horreur n’est pas très présente dans le reste de votre œuvre, pourquoi cette incursion dans le genre ?
MF : Je n’ai pas commencé Panorama en pensant que ce serait une histoire d’horreur. C’est la direction qu’ont prise les personnages. Je ne m’attendais pas à ce que cette crise existentielle et identitaire se transforme ainsi. Mais il faut bien avouer que le genre est précisément ce par quoi j’étais obsédé dans mes dessins à l’époque. Je pense donc que cette crise n’avait pas d’autres choix que celui de passer par le prisme de l’horreur organique. Pour moi, c’est ainsi que la forme et le contenu de Panorama se sont finalement rencontrés.
RD: Pourquoi cette obsession pour l’horreur ?
MF : Impossible pour moi de vous répondre sans immédiatement créer quelque chose… Je ne peux donc vous en dire plus.
RD : La musique est également très présente dans l’histoire. Pouvez vous me parler de votre relation avec le média ? En écoutez-vous beaucoup lorsque vous créez ?
MF : Ce n’est que lorsque je dessine que j’écoute des choses, des disques, des podcasts, de vieilles cassettes de mixage. La musique à joué un plus grand rôle dans ma vie à un certain moment, celui ou je faisais partie de groupes, ou je travaillais dans un club, celui ou je faisais de la bande dessinée à mes heures perdues. A ce moment, j’ai découvert que je m’intéressais à la visualisation du son à travers la BD, pas seulement les effets sonores, cela a déjà été bien couvert – mais véritablement la musique. Cela n’a vraiment été une préoccupation active que dans des travaux ultérieurs.
RD : Comment cette visualisation a-t-elle été exprimée ?
MF : Par des lignes, des formes abstraites ou une utilisation bien particulière des couleurs. J’en ai quelques exemples dans mon autre roman graphique, Zegas, que je vous dévoile en partie ici.
1/Sur celle-ci, je me suis demandé quelles étaient les façons de représenter la musique sous une forme silencieuse mais néanmoins très visuelle, en utilisant des couleurs et des symboles pour la montrer.

2/Dans cette autre page de Zegas, j’ai utilisé des couleurs, des symboles et des effets sonores pour créer l’illusion de la musique et des battements. Le découpage de la page joue également un rôle qui n’est pas sans rappeler celui d’un rythme régulier (qui sera finalement subvertit à la fin de la page).

3/Ce travail n’est pas de moi mais du magistral Jaime Hernandez. Il visualise la musique de différentes manières dans Love & Rockets. Dans les numéros 17, 28, 39, elle est par exemple un courant qui disparaît pour suggérer un bruit sourd dans un club, une vague céleste qui transporte presque les auditeurs ou un assaut, dur et plus grand que nature. Le tout en quelques lignes seulement.

RD : L’histoire de Panorama interroge notre rapport au genre, que pensez-vous du genre aujourd’hui ?
MF : Je l’envisage dans la mesure où le paysage culturel le définit. Dans Panorama, je me concentrais sur deux personnalités bien spécifiques, je ne les utilisais pas comme des prétextes pour raconter des concepts supplémentaires, qui plus est extérieurs à leur propre combat. Le genre faisait partie de cette dynamique, il n’en était pas LA dynamique.
RD : Avec le recul, comment voyez-vous Panorama aujourd’hui ?
MF : Je le vois comme une tentative sincère de communication de la part d’un jeune dessinateur affamé. Je ne lis pas mes anciens travaux, mais je très suis fier de l’avoir fait.

RD : Qu’en est-il des débuts de Copra ?
MF : Je les vois comme le besoin de créer le genre d’histoire que j’ai apprécié toute ma vie mais que j’évitais à tout prix: la bande dessinée d’action, le récit de vengeance et de super-héros format périodique.
RD : Pourquoi vouliez vous l’éviter ?
MF : Parce que je doutais énormément. Je pensais que je devais me concentrer sur des sujets plus « sérieux ». Ce sont évidemment des conceptions idiotes et superficielles et il m’a fallu une minute pour m’en rendre compte.
Puis, comme je voulais complètement en contrôler la production, l’écriture et la coloriser selon mes besoins spécifiques, sans aucune surveillance ni limitation, la seule façon d’y parvenir était donc de la publier moi-même.
RD : Dans quel état d’esprit étiez-vous lorsque vous avez commencé à le créer ?
MF : Je voulais vraiment créer dans l’immédiateté et sans aucun esprit carriériste. C’était une bande dessinée faite pour me faire plaisir et, je l’espère, pour faire plaisir à quelques amis dessinateurs. Ma devise c’était: faire ou mourir.
RD : A la fin du premier tome, vous évoquez dans votre façon de créer un élément appelé « Le mur de Kirby ».
MF : Oui. C’est avant tout une histoire de rythme de production: débiter des pages, avancer, et surtout ne pas s’imaginer réécrire quoi que ce soit. Il ne s’agit pas pour autant de composer des pages à la va-vite mais simplement de ne pas se laisser paralyser par ses exigences. C’est une méthode qui permet de s’écarter de sa propre psychologie pour produire plus efficacement.
Jusque-là, j’avais été très méticuleux dans mon travail mais en me débarrassant de cette attitude, j’ai découvert que mes résultats ne souffraient pas nécessairement si j’allais plus vite. Ils étaient même parfois meilleurs en les surmenant.
RD : Est-ce la façon dont vous travaillez encore aujourd’hui ?
MF : Une partie de cette méticulosité s’insinue encore de temps en temps, mais j’essaie de m’en souvenir et de maintenir ce rythme soutenu. J’aime le rythme imposé par cette méthode, elle m’a permis de comprendre une partie des comics que j’aimais, surtout les plus anciens, les plus décomplexés.
RD : Justement, beaucoup disent que Copra est un hommage à peine voilé à certaines bandes dessinées des années 1980 ?
MF : Il y a bien un hommage mais je ne dirai pas qu’il est à peine voilé et surtout il ne se limite pas qu’aux bandes dessinées des années 1980. Il y a peut-être une touche en effet, mais je m’inspire aussi des années 70 et 90, des bandes dessinées modernes, des beaux-arts et de la mode. J’utilise tout ce que je peux pour garder mon inspiration. Pour moi Copra, ne ressemble à rien qui vienne des années 1980.
RD : Pendant un instant, j’ai cru reconnaître la touche de Jean-Michel Nicollet, un dessinateur proche de Métal Hurlant, notamment dans un portrait de Gracie. Graphiquement, avez-vous des influences d’artistes français ou européens ?
MF : Le style de Nicollet est étonnant mais je ne le citerais pas comme une influence. Vous évoquez le personnage de Gracie, elle a été spécifiquement inspirée par la collaboration que Keith Haring a eue avec Grace Jones. En Europe, je suis constamment époustouflé par des dessinateurs comme Christophe Blain, Lorenzo Mattotti et José Muñoz.


RD : Quand ils ne sont pas physiques, les pouvoirs de certains personnages semblent souvent liés à des actions psychiques ou des possessions de l’esprit, pourquoi cette approche ?
MF : La représentation visuelle des super-pouvoirs peut être aussi vaste et sauvage que tout ce que vous pouvez imaginer et elle a été désespérément malmenée dans certains comics. La principale raison qui fait que ces pouvoirs sont liés à des actions de l’esprit est de me permettre de justifier des approches visuelles peu orthodoxes, car pour moi elles doivent avant tout être très inventives.
RD : Quelle est l’influence du cinéma sur votre travail ?
MF : Toute évocation du cinéma dans mes bandes dessinées est purement inconsciente. Je suis convaincu que pour que la bande dessinée continue d’évoluer, elle doit s’affranchir de la main de fer du cinéma. C’était bien quand le médium se développait, mais il devrait maintenant cesser d’essayer d’être un film couché sur papier.

RD : L’influence des Frères Hernandez est évidente sur Panorama, moins sur Copra et encore plus sur Zegas, un autre de vos projets pas encore traduit en France. Pouvez-vous m’en parler ?
MF : Panorama était en noir et blanc, en raison des limites de production que j’avais à l’époque. Je n’avais pas d’ordinateur, ni de Photoshop, et les éditeurs n’étaient pas intéressés par les travaux en couleur, car très difficiles à reproduire. Je me suis donc contenté du noir et blanc. Zegas a été mon incursion dans la couleur et son application a encore poussé mon travail à un tout autre niveau. Fantagraphics a fait un excellent travail en le publiant.
RD :Pouvez-vous résumer Zegas en quelques mots ?
MF : C’est un conte surréaliste et urbain au service de l’ambition, de l’intégrité, du sexe et de la mort. J’espère qu’il sera bientôt traduit chez vous.